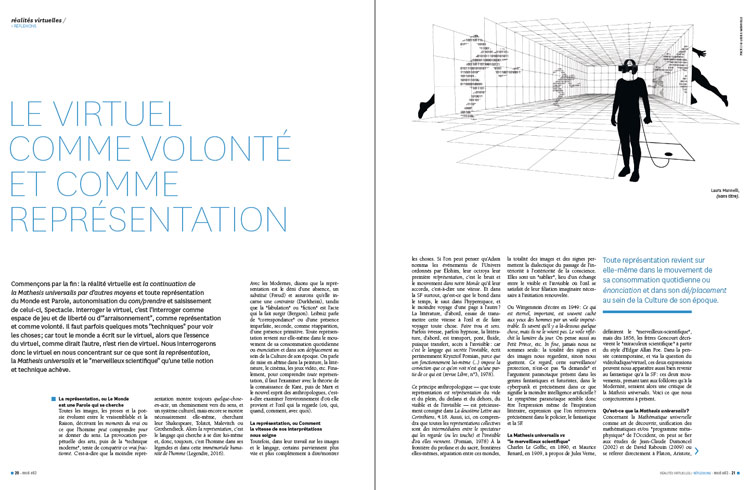comme volonté et comme représentation
Commençons par la fin : la réalité virtuelle est la continuation de la Mathesis universalis par d’autres moyens et toute représentation du Monde est Parole, autonomisation du com/prendre et saisissement de celui-ci, Spectacle. Interroger le virtuel, c’est l’interroger comme espace de jeu et de liberté ou d’ »arraisonnement », comme représentation et comme volonté. Il faut parfois quelques mots « techniques » pour voir les choses ; car tout le monde a écrit sur le virtuel, alors que l’essence du virtuel, comme dirait l’autre, n’est rien de virtuel. Nous interrogerons donc le virtuel en nous concentrant sur ce que sont la représentation, la Mathesis universalis et le « merveilleux scientifique » qu’une telle notion et technique achève.
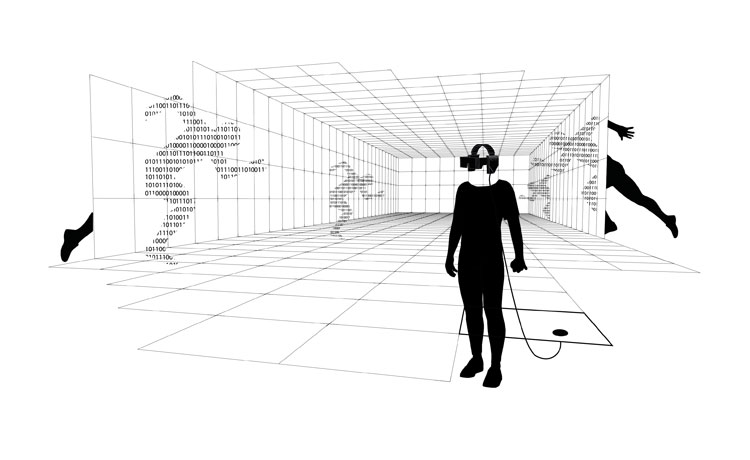
Laura Mannelli, (sans titre). Photo: © Laura Mannelli.
La représentation, ou Le Monde est une Parole qui se cherche
Toutes les images, les proses et la poésie évoluent entre le vraisemblable et la Raison, décrivant les moments du vrai ou ce que l’homme peut comprendre pour se donner du sens. La provocation perpétuelle des arts, puis de la « technique moderne », tente de conquérir ce vrai fractionné. C’est-à-dire que la moindre représentation montre toujours quelque-chose–en-acte, un cheminement vers du sens, et un système culturel, mais encore se montre nécessairement elle-même, cherchant leur Shakespeare, Tolstoï, Malevitch ou Grothendieck. Alors la représentation, c’est le langage qui cherche à se dire lui-même et, donc, toujours, c’est l’homme dans ses légendes et dans cette immémoriale humanité de l’homme (Legendre, 2016).
Avec les Modernes, disons que la représentation est le déni d’une absence, un substitut (Freud) et assurons qu’elle incarne une contrainte (Durkheim), tandis que la « fabulation » ou « fiction » est l’acte qui la fait surgir (Bergson). Leibniz parle de « correspondance » ou d’une présence imparfaite, seconde, comme réapparition, d’une présence primitive. Toute représentation revient sur elle-même dans le mouvement de sa consommation quotidienne ou énonciation et dans son dé/placement au sein de la Culture de son époque. On parle de mise en abîme dans la peinture, la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Finalement, pour comprendre toute représentation, il faut l’examiner avec la théorie de la connaissance de Kant, puis de Marx et le nouvel esprit des anthropologues, c’est-à-dire examiner l’environnement d’où elle provient et l’œil qui la regarde (où, qui, quand, comment, avec quoi).
La représentation, ou Comment la vitesse de nos interprétations nous soigne
Toutefois, dans leur travail sur les images et le langage, certains parviennent plus vite et plus complètement à dire/montrer les choses. Si l’on peut penser qu’Adam nomma les événements de l’Univers ordonnés par Élohim, leur octroya leur première re/présentation, c’est le bruit et le mouvement dans notre Monde qu’il leur accorda, c’est-à-dire une vitesse. Et dans la SF surtout, qu’est-ce que le bond dans le temps, le saut dans l’hyperespace, et le moindre voyage d’une page à l’autre ? La littérature, d’abord, essaie de transmettre cette vitesse à l’œil et de faire voyager toute chose. Faire trou et sens. Parfois ivresse, parfois hypnose, la littérature, d’abord, est transport, pont, fluide, puisque transfert, accès à l’invisible : car c’est le langage qui secrète l’invisible, écrit pertinemment Krysztof Pomian, parce que son fonctionnement lui-même (…) impose la conviction que ce qu’on voit n’est qu’une partie de ce qui est (revue Libre, n°3, 1978).
Ce principe anthropologique — que toute représentation est re/présentation du vide et du plein, du dedans et du dehors, du visible et de l’invisible — est précieusement consigné dans La deuxième Lettre aux Corinthiens, 4.18. Aussi, ici, on comprendra que toutes les représentations collectives sont des intermédiaires entre le spectateur qui les regarde (ou les touche) et l’invisible d’où elles viennent. (Pomian, 1978) À la frontière du profane et du sacré, frontières elles-mêmes, séparation entre ces mondes, la totalité des images et des signes permettent la dialectique du passage de l’intériorité à l’extériorité de la conscience. Elles sont un « sablier », lieu d’un échange entre le visible et l’invisible où l’œil se satisfait de leur filiation imaginaire nécessaire à l’initiation renouvelée.
Ou Wittgenstein d’écrire en 1949 : Ce qui est éternel, important, est souvent caché aux yeux des hommes par un voile impénétrable. Ils savent qu’il y a là-dessous quelque chose, mais ils ne le voient pas. Le voile réfléchit la lumière du jour. On pense aussi au Petit Prince, etc. In fine, jamais nous ne sommes seuls : la totalité des signes et des images nous regardent, sinon nous guettent. Ce regard, cette surveillance/protection, n’est-ce pas « la demande » et l’argument paranoïaque présent dans les genres fantastiques et futuristes, dans le cyberpunk et précisément dans ce que signifie la moindre intelligence artificielle ? Le symptôme paranoïaque semble donc être l’expression même de l’inspiration littéraire, expression que l’on retrouvera précisément dans le policier, le fantastique et la SF.
La Mathesis universalis vs « le merveilleux scientifique »
Charles Le Goffic, en 1890, et Maurice Renard, en 1909, à propos de Jules Verne, définirent le « merveilleux-scientifique », mais dès 1856, les frères Goncourt décrivirent le « miraculeux scientifique » à partir du style d’Edgar Allan Poe. Dans la pensée contemporaine, et via la question du vidéoludique/virtuel, ces deux expressions peuvent nous apparaître aussi bien revenir au fantastique qu’à la SF : ces deux mouvements, prenant tant aux folklores qu’à la Modernité, seraient alors une critique de la Mathesis universalis. Voici ce que nous conjecturerons à présent.
Qu’est-ce que la Mathesis universalis ?
Concernant la Mathématique universelle comme art de découvrir, unification des mathématiques et/ou « programme métaphysique » de l’Occident, on peut se fier aux études de Jean-Claude Dumoncel (2002) et de David Rabouin (2009) ou se référer directement à Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Husserl, Heidegger, Pierre Legendre et Guy Debord peut-être. Il s’agit d’une science générale des grandeurs de l’Univers : toutes les sciences spéciales que l’on nomme Mathématiques (l’Arithmétique, la Géométrie, la Mécanique et les sciences mixtes ou appliquées qui dépendent de celles-là) [n’étant] que des branches de la Mathématique universelle. (Bouveresse 1994). Descartes parle de « l’arbre du savoir » (1644) et Husserl (1976) de science des formes-de-sens du « quelque chose » en général.
À la fois cause et effet, l’histoire de cette logique formelle ou algorithmique de l’infini (Leibniz) semble être également l’histoire mondiale de l’emprise du contrôle et de la mesure de l’homme par l’homme (Crosby, 2003) ; emprise romancée par toutes les sciences-fictions, dénoncée par J.G. Ballard et Philip K. Dick, et personnifiée par Hari Seldon, le psychomathématicien du cycle Fondation d’Isaac Asimov, et figurée par le Jihad Butlérien de Franck Herbert dans le cycle Dune, etc.
Ainsi la Mathesis pourrait-elle être l’autre nom de l’Occident, le masque de sa trajectoire technique, puis de son système des sciences. La formule latine paraît en effet décrire, et prédire, l’arraisonnement de la Nature, mot de Heidegger, et, par conséquent, de l’Homme, par le dispositif techno-économique, mot de Leroi-Gourhan. Elle serait donc le plan de la raison occidentale et son « institution imaginaire » se révélant à elle-même. Vertigineux… Dès lors, comment ne pas saisir que la définition historique et la venue du « miraculeux scientifique » font pleinement partie dudit « plan » ?
Qu’est-ce que « le merveilleux scientifique » ?
Les proses fondatrices de Poe, Théophile Gautier, H.G. Wells, H.P. Lovecraft et Verne, possédant une fonction prévisionnelle et parfois un pouvoir divinatoire (Goimard, 2002), semblent voir plus loin et s’affirment comme les premiers radiotélescopes du fantastique et de la SF à venir, et leurs auteurs, comme leurs premiers opérateurs. Dans un cinéma plus contemporain, cette réflexivité gothique confirme sa présence tout particulièrement dans Shining (Kubrick, 1980), Freddy 7 (Craven, 1994) et L’antre de la folie (Carpenter, 1998) et sans doute dans le serial adolescent Destination finale (2000, 2003, 2006, 2009, 2011). Prémonition inquiète. Mise en abîme. Trous dans la pellicule. Dès lors, cette fiction consciente d’elle-même ou « miraculeux scientifique », se fait prodrome, annonce d’un événement.
Dans le fantastique et la SF, l’écrivain et le scénariste retrouvent la destination de l’écriture, son terme et sa racine, entre la physique et la métaphysique, et symbolisent quelque chose qui vient. L’écriture comme pont – ou jump. Un auteur de fiction, ou de ce qu’il prend pour de la fiction, est capable d’écrire la vérité sans le savoir, écrit Philip K. Dick dans Si le monde vous déplait… (1998). Car la fonction des arts, et précisément des livres, et particulièrement ceux liés au « merveilleux scientifique », est de servir, sans trop le savoir, d’intermédiaire entre les mortels et les immortels, quels que soient les modes culturels et symboliques de transport. La fiction en générale, qui a pour fonction de se détacher de la masse des objets communs, se fait alors offrande insolite et spectaculaire, défi à la curiosité et à l’imagination des visiteurs qu’elle arrache au réel et renvoie vers l’invisible d’où elle vient. L’invisible ? Ce que l’on ne comprend pas : l’insaisissable, l’inaccessible, la poésie…
Si l’histoire plutôt consciente de la Mathesis — comme plan d’unification de la culture européenne — s’avère être « la véritable histoire du Monde », alors le fantastique et la SF pourront aussitôt se comprendre soit comme l’enzyme d’activation, soit comme le parasite de cette Culture, the ghost in the machine. – C’est-à-dire ? C’est-à-dire se comprendre comme l’envers, la poétisation de l’indomptable, à la fois « pulsion d’horreur » et/ou « négativité critique » de la géométrisation du Monde, de son contrôle, et aussi comme l’endroit – le prolongement de la machine… Depuis le travail de traduction/symbolisation des arts, cette pulsion d’horreur face à la pulsion de savoir — libido sciendi —, nous reviendrait comme critique du rêve de domination universelle qu’est la Mathesis. On comprendra mieux, alors, tous nos jeux et nos jeux vidéo, et notre passion pour la destruction festive du Monde (Morin Ulmann, 2013).
Très tôt, chez Cyprien Bérard, Alexandre Dumas, Isidore Ducasse, Marey Shelley ou Bram Stocker, la littérature fantastique a su nous décrire cette « pulsion critique » et/ou remontée du fond des âges. Un refoulé. Avec d’autres particularités simplement culturelles, j’avance que les œuvres de Barjavel, la nouvelle Le dernier rivage (1957) de Nevil Shute — aussitôt réalisée par Hollywood (On the beach, Kramer, 1959 ; USS Chaleston, Mulcahy, 2000) – et Malevil de Robert Merle (1977), et Crash de Ballard (1974), et Krysnah ou le complot de Walther (1978), et le cyberpunk, sont le prolongement de cette ombre de la machine/Mathesis — comme tous les jeux vidéo.
Et les images ?
Dans le système des imageries cinématographiques, cette pulsion d’horreur — ou négativité de l’esprit de la science — réapparaît avec les Metropolis (1927) et M le maudit de Fritz Lang (1931), et le Frankenstein de James Whale (1931), jusqu’au robot-ordinateur dément de 2001 (Kubrick, 1968), puis Mondwest (Crichton, 1973), et dans « l’humanisme critique » de Terminator (Cameron, 1984) ou de Matrix (Wachowski, 1999), etc. Cette force vitale, sans état d’âme ni direction, se manifeste également dans tous les serials où croquemitaines ignobles, boogeymen repoussants et autres « guerriers fous » exhibent le masque de l’inéluctabilité et de la putréfaction (Texas Chain Saw Massacre, Halloween, Vendredi 13, Alien, Predator & autres Freddy). On peut sans doute avancer qu’avant les jeux vidéo eux-mêmes, ces nombreux films à petits budgets formalisent, à leur manière, une énergie réfractaire au programme de la Mathesis, c’est-à-dire que ces films critiquent et conspuent notre « cage de l’avenir » (Weber, 1921). Depuis la fin des années 60, ces représentations inquiètes correspondent au Malaise dans la science-fiction américaine dont parle Gérard Klein (Le Guin, 2000).
L’art est un déniaisement
Dans son Esthétique négative (1983), Marc Jimenez, après Siegfried Kracauer (1973), Edgar Morin (1956) et Marc Ferro (1977), explique que l’exigence théorique et philosophique en esthétique est incluse dans le projet d’une théorie critique de la société, et l’esthétique demeure philosophique dans la mesure où elle assume la critique permanente du statut et de la fonction de l’art à l’intérieur de la société contemporaine, à partir des œuvres elles-mêmes. Cette exigence suppose que l’œuvre d’art puisse apparaître comme un moment essentiel de cette critique, lieu d’expression des antagonismes sociaux. Cette hypothèse, qui est aussi celle de Bertolt Brecht et de Louis Althusser, énonce que l’art a pour fonction critique de nous déniaiser, de désidéologiser ce que nous prenons pour la réalité, d’y faire des trouées. Dès lors, les arts — et, paradoxalement, les jeux vidéo — sont un moyen de produire la volonté de transformer le Monde, puisqu’ils en peignent un tableau critique, c’est-à-dire lui donne un autre sens, négatif critique, que nous pourrions/devrions nous approprier.
Donc, comme le formulèrent préalablement Hegel et Marx, T.W. Adorno, Henri Lefebvre et les situationnistes : l’esthétique est un moment critique de l’économie politique. Et réciproquement. Puisque, pour prospérer, la fabulation eut toujours besoin de l’action des techniques, puis du système des sciences, celles-ci ont pareillement besoin de l’énergie sociale des fictions — ou pulsion d’horreur — pour leur revenir comme soutien mythologique et critique ; on parlera de poétique de la science.
Le miraculeux scientifique du virtuel est, en conséquence, 1) la continuation de la Mathesis universalis par d’autres moyens (d’apprivoiser/théoriser le Monde) et 2) cette religion ordinaire et positive que le Monde nouveau réclamait, et avec laquelle il se soule. Positive, au double sens du terme : comme adoration de la science et adoration de la critique de la science : il y a rêverie et critique de la rêverie dans la rêverie même (mise en abîme, emploi narratif et financier du réel pour le dénoncer) — Comment ne pas penser à tous ces films et jeux vidéo, et à la publicité même, aujourd’hui, où tout tourne autour du décalage badin, de l’ironie, des jeux de miroir ? Ainsi, le miraculeux scientifique du virtuel est-il tout à la fois croyance positive dans l’arraisonnement de la Nature, sa domestication, et dans celui des hommes par le dispositif techno-économique — la productivité et ses potentialités — ainsi que croyance dans sa critique récurrente, inachevable, désespérée même.
David Morin Ulmann
Anthropologue, spécialiste de la modernité et du capitalisme
publié dans MCD #82, « Réalités Virtuelles », juillet / septembre 2016